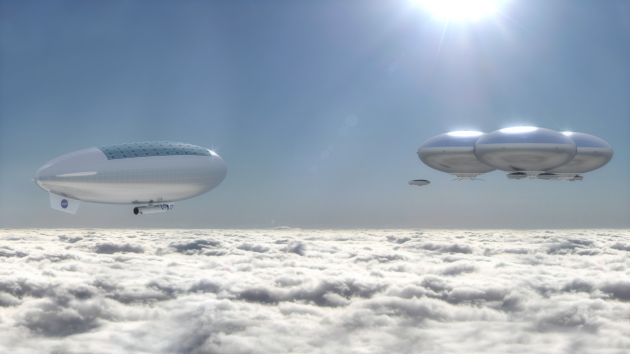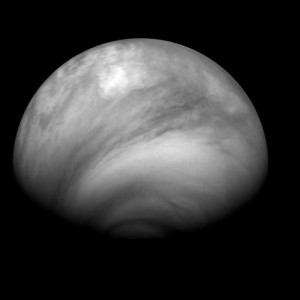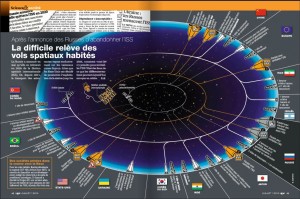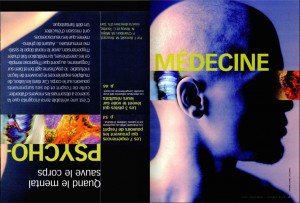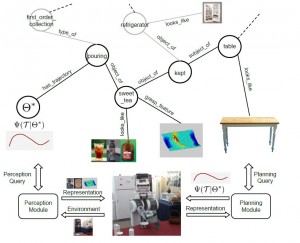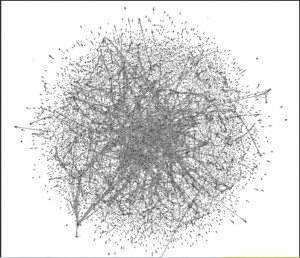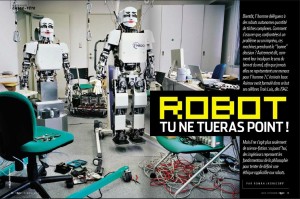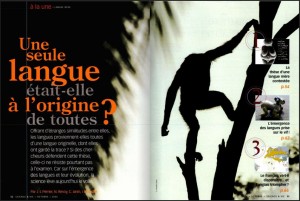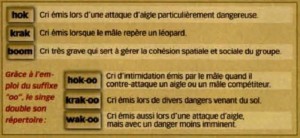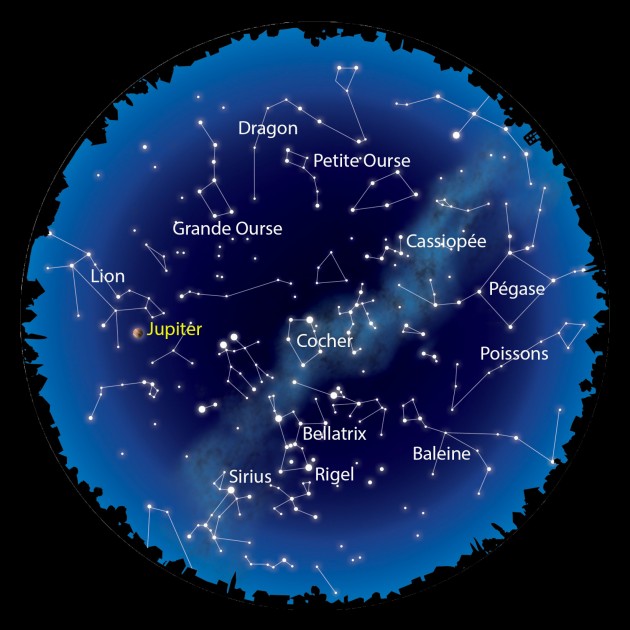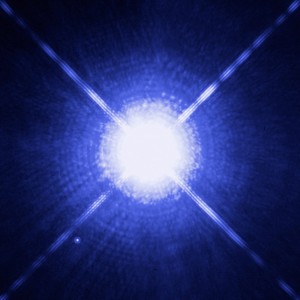Il est vrai que ces petites baies bleues à la saveur légèrement sucrée sont réputées améliorer la vue et réduire le risque de maladies visuelles. Certains de leurs composés seraient en effet censés protéger ou favoriser la production d’éléments indispensables à la vue… Mais aucune étude ne l’a jamais démontré. Cette idée s’est répandue après que des pilotes ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, rapporté une amélioration de leur vision la nuit, après avoir mangé de la confiture de myrtilles (Vaccinium myrtillus)…
Depuis, plusieurs études ont suggéré, sans toutefois le démontrer rigoureusement, que ces fruits pourraient non seulement améliorer la vision de nuit, mais aussi réduire la survenue de maladies pouvant mener à la cécité, comme la cataracte (opacification du cristallin) ou une dégénérescence maculaire (détérioration de la macula, zone très innervée de la rétine). De tels effets pourraient notamment découler des anthocyanosides, ces pigments qui colorent les myrtilles en bleu.
Pas d’étude rigoureuse sur l’effet des myrtilles
Présents aussi dans la mûre ou le raisin noir, ils seraient susceptibles d’agir de deux façons. Ils favoriseraient la production de “rhodopsine”, une substance responsable de la sensibilité de l’œil à la lumière. Et ils protégeraient la rétine, par exemple, des radicaux libres, ces composés qui dérivent de l’oxygène et qui endommagent les cellules, favorisant ainsi le vieillissement.
Reste que l’Armée américaine, intéressée par ce potentiel, n’a pas réussi à le démontrer. En 2000, le Laboratoire américain de recherche médicale de la marine et de l’aérospatiale a conclu que la prise d’extraits de myrtilles 3 fois par jour pendant 21 jours n’améliore pas la vision de nuit.
I.B.
> Lire également dans les Grandes Archives de Science & Vie :
- Aliments, leurs gènes modifient les nôtres – S&V n°1134 – 2012 – « L’homme est ce qu’il mange » disait le philosophe allemand Ludwig Feuerbach. Et il ne savait pas si bien dire : selon des études récentes l’information génétique des végétaux pénètrent nos cellules et nous transforment !
- Alicaments : le dossier vérité – S&V n°1129 – 2011 – Le concept d’ « alicament », contraction d’aliment et médicament, est à la mode depuis quelques années. L’idée est d’améliorer sa santé via des aliments particuliers, telles les myrtilles pour la vue. Mais cet engouement ne repose pas sur des preuves concrètes. Le point sur la question avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
- Tout ce qu’il faut savoir sur les compléments alimentaires – S&V n°1159 – 2014 – 41 % des Français avouent prendre des compléments alimentaires : vitamines, minéraux, extraits de plantes… Mais leur efficacité est souvent factice, voire contre-productive. Enquête.