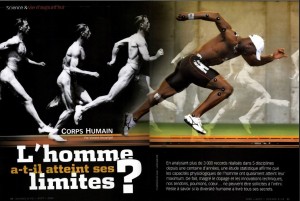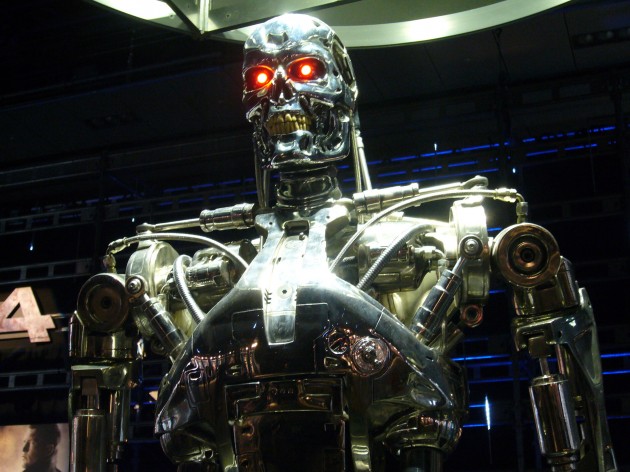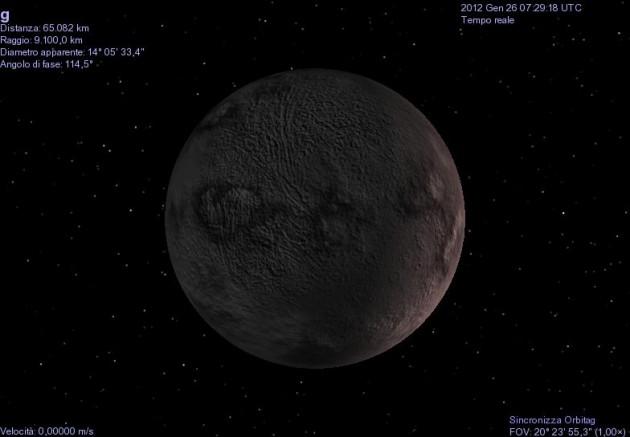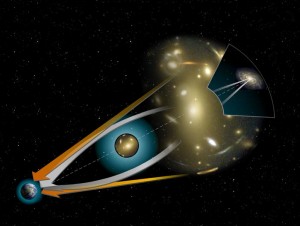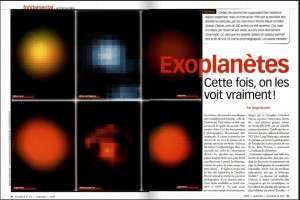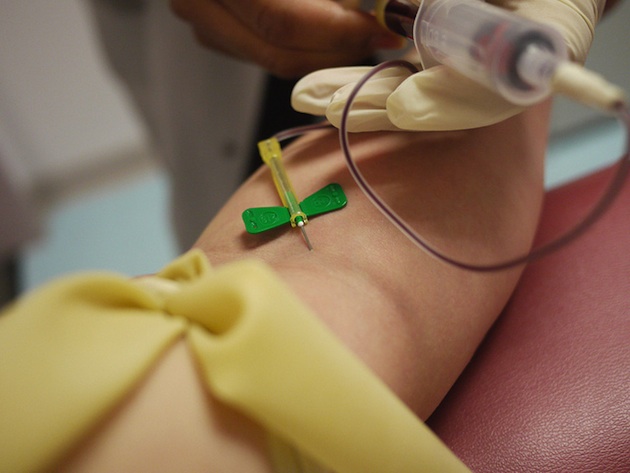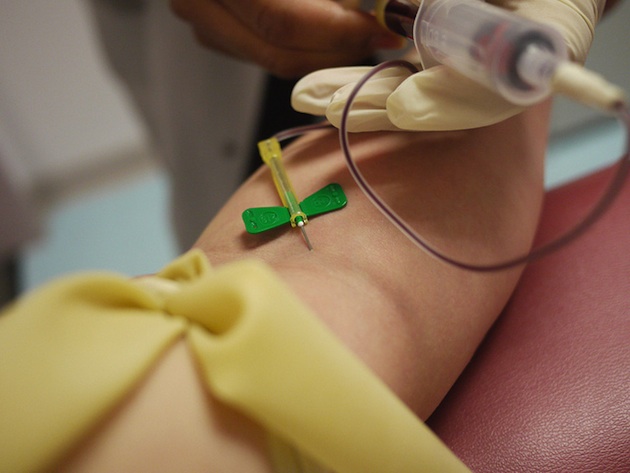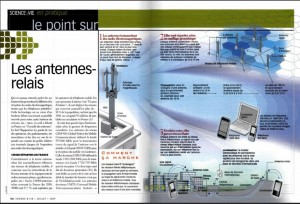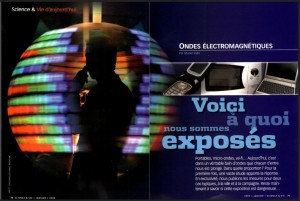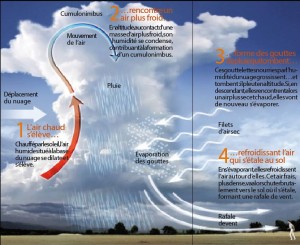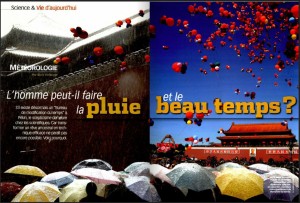Chacun en a fait l’expérience : alors qu’on peut marcher une bonne heure sans se sentir fatigué, attendre un bus ou contempler des œuvres d’art au musée se révèle très vite épuisant. Il y a plusieurs explications à cela.
Premièrement, la posture debout n’est pas une position de repos pour le corps humain : tout le poids du corps repose alors sur la plante des pieds, ce qui est fatigant à la longue. Surtout, pour maintenir son équilibre, un ensemble de muscles dits “posturaux”, dans les mollets et les hanches, travaillent conjointement pour ajuster une posture sans cesse perturbée par les phénomènes extérieurs (gravité, vent) et intérieurs (battements du cœur, respiration).
Marcher demande de se rééquilibrer constamment
Comme l’explique Alain Hamaoui, du groupe de physiologie de la posture et du mouvement à l’université Champollion d’Albi, “l’équilibre ne s’obtient que si le centre de gravité du corps se situe au-dessus du polygone de sustentation”, c’est-à-dire la surface au sol comprise entre les pieds. Le cerveau est informé de la position du centre de gravité par les propriocepteurs, des capteurs sensoriels situés dans les articulations et les muscles ; à chaque écart de la position de référence, il enclenche des réajustements au niveau des articulations des chevilles et des hanches. Le muscle le plus sollicité est le triceps sural, le muscle principal du mollet. Il nous empêche de basculer en avant, car la ligne de gravité tombe devant les chevilles. Pour cela, il lui suffit de se contracter périodiquement, ce qui nécessite seulement 10 % de son effort maximal. Mais alors, comment expliquer la fatigue ?
Des messages d’alerte
En passant du temps debout sans bouger, la gravité fait s’accumuler le sang dans les veines des jambes. Celles-ci sont équipées de valves qui l’empêchent de circuler à contre-courant, mais le cœur n’est pas assez puissant pour le pomper complètement. “Trois mécanismes interviennent pour pallier cela, indique Alain Hamaoui, l’appui alterné sur les semelles plantaires, qui chasse le sang vers les mollets ; la contraction périodique du triceps sural, qui fait office de pompe ; et les changements de pression cycliques dus à la respiration, qui créent une aspiration vers le haut.” Or, si la posture debout est maintenue trop longtemps, le volume de sang en circulation diminue, il est de moins en moins bien oxygéné par les poumons, et la pression artérielle est réduite au minimum. Des messages d’alerte sont alors produits dans les grandes artères… jusqu’à provoquer l’évanouissement.
Au contraire, en marchant, les muscles des jambes, du tronc et de la ceinture pelvienne sont mobilisés. Si cela induit un coût énergétique supérieur, il reste suffisamment modéré pour se poursuivre longtemps sans fatigue. Et puisqu’on avance un pied à la fois, l’autre pied est toujours soulevé, ce qui accorde à une des jambes un instant de “détente” à chaque pas… équivalant à la moitié du temps de marche. De plus, chaque pas que l’on pose exerce une poussée du sang veineux vers le haut, stimulant la circulation, d’autant plus que le cœur, sollicité par l’effort, bat à un rythme plus soutenu qu’à la station debout.
F.G.
> Lire également dans les Grandes Archives de Science & Vie :
Test : Bougez-vous assez ? – S&V n°1083 – 2007 – Marcher plutôt que rester immobile. L’évolution a favorisé la bipédie chez les hominidés car cette morphologie avait l’avantage de permettre aux individus de courir plus vite et plus longtemps – devant un prédateur ou derrière une proie. Mais aujourd’hui, c’est l’immobilité qui prévaut dans la vie professionnelle et privée. Des habitudes à contre-courant de notre nature de coureurs de fond que nous payons cher. Et vous, bougez-vous assez ?
- L’homme a-t-il atteint ses limites ? – S&V n°1091 – 2008 – Le corps humain, en particulier celui des sportifs, peut-il développer chaque fois plus de capacités physiques ? Certainement pas, disent les scientifiques. Mais avec l’aide de la technologie et beaucoup d’imagination, il n’y a pas de limite qui tienne.